🇪🇨 « Paro nacional » 2025. Mobilisations et répression en Équateur (revue de presse)
Lancée le 23 septembre par la CONAIE, principale organisation indigène de l’Équateur, la grève nationale contre la suppression de la subvention du diesel est brutalement réprimée par les Forces armées. La violence de l’armée a déjà fait une victime mortelle : Efraín Fuerez, membre de la communauté kichwa de Cuicocha, abattu de trois balles par des militaires le 28 septembre. Un autre manifestant est actuellement dans un état critique. Actuellement, la grève se poursuit et s’étend malgré le climat de terreur causé par l’expansion de la militarisation dans les territoires kichwa. Les manifestants réclament justice pour l’ensemble des victimes de la répression du gouvernement équatorien.

Le 2 octobre, face au refus de dialogue du gouvernement, à sa délégitimation du mouvement et à la violence de la répression, le Conseil élargi de la CONAIE a appelé à la poursuite du mouvement
– pour l’abrogation du décret 126, qui a supprimé la subvention au diesel
– la défense de la terre, de l’eau et des territoires contre l’extractivisme
– des moyens pour l’éducation et la santé publique
– la réduction de la TVA de 15% à 12%
– vérité, justice et réparation pour les victimes de la répression, en particulier pour la mort d’Efraín Fuerez.
Revue de presse / Artículos en español más abajo.
« Abattu de trois balles par les forces armées » : la répression des manifestations fait sa première victime en Équateur (Luis Reygada / L’Humanité)
Alors que le pays sud-américain est secoué depuis une semaine par des protestations face à la montée du prix du diesel, le gouvernement du président Daniel Noboa n’hésite pas à assimiler ses opposants à « des terroristes » et à lancer les militaires contre la population. Une rapporteuse de l’Onu dénonce « une campagne de persécution contre la société civile et les mouvements sociaux ».

Une semaine de protestations et déjà un manifestant tué par les forces sécuritaires en Équateur. Sept jours après le lancement d’une grève nationale illimitée par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (CONAIE) pour s’opposer à la suppression de la subvention sur le diesel décrétée par le gouvernement, la principale organisation indigène du pays a dénoncé ce dimanche « l’assassinat » d’un manifestant « abattu de trois balles par les forces armées sur l’autoroute Panaméricaine Nord » dans le cadre de « la répression ordonnée par le président Daniel Noboa ».
La scène, filmée la veille à Cotacachi (province de Imbabura, nord) par une caméra de surveillance et largement partagée sur les réseaux sociaux, est d’une grande violence : elle montre des militaires passer à tabac un homme essayant de porter secours à Efraín Fuerez, un membre de la communauté kichwa âgé de 46 ans gisant sur le sol et qui décèdera quelques heures plus tard à l’hôpital suite à ses blessures.
Dénonçant un « crime d’État » et un « massacre en cours », la CONAIE a fustigé un gouvernement autoritaire qui aurait « transformé le pays en champ de bataille contre son propre peuple ». Vidéos de l’intense militarisation de la répression à l’appui, l’organisation a dénoncé l’utilisation par les forces de police et militaires d’armes létales – ainsi que d’explosifs – pour mater les communautés, souvent indigènes, participant au soulèvement. (…)
(…) Lire la suite de l’article ici
Voir la communiqué de France Amérique Latine en français et en espagnol : Répression en Équateur : solidarité avec les communautés indigènes et les mouvements populaires
Appel à la mobilisation et à solidarité internationale face à la répression en Équateur (Tribune / L’Humanité)
Lancée il y a une semaine par la principale organisation indigène de l’Équateur (Conaie), la grève nationale illimitée dénonçant l’augmentation des prix du carburant est réprimée avec férocité par les forces militaires aux ordres du président Daniel Noboa. « Tirs à balles réelles », « dizaines de détentions arbitraires », « cas de disparitions et de torture », « climat de terreur »….
Alors que la mort d’un manifestant est déjà à déplorer et que le gouvernement n’hésite pas à assimiler les protestataires à des « terroristes », l’Humanité partage une tribune des chercheuses Sisa Calapi et Salomé Cárdenas Muñoz, dans laquelle elles appellent à tourner le regard vers le pays sud-américain pour exiger la fin de la répression.

Le lundi 22 septembre 2025, une grève nationale et illimitée a débuté en Équateur. Cette dernière est menée par la CONAIE (Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur), la plus grande organisation indigène du pays, ainsi que par d’autres organisations indigènes dans diverses provinces. Cette mobilisation fait suite à l’annonce du décret exécutif 126 qui élimine la subvention du diesel. Elle se réalise également en réaction au projet de modification de la constitution de 2008, qui garantit des droits fondamentaux relatifs à l’autodétermination des peuples indigènes, les droits de la nature et l’accès à l’éducation et à la santé. Suite à la mobilisation, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence dans 8 provinces et un couvre-feu dans 5 d’entre elles.
Au-delà du décret 126, le mouvement en cours dénonce la crise sociale que traverse l’Équateur face au déclin de l’accès à la santé, à l’éducation, la sécurité sociale tout en dénonçant le coût de la vie élevé ainsi que le climat de violence généralisé, suite à la montée du narcotrafic. Il dénonce également les politiques extractivistes qui favorisent le déploiement de compagnies étrangères exploitant des mines et du pétrole dans des réserves naturelles protégées, en toute impunité.
Les mobilisations se déroulent actuellement à Quito, la capitale, mais aussi dans d’autres provinces, à travers la mise en place de blocus visant à paralyser le pays. Une des plus grandes concentrations a lieu dans la province d’Imbabura, où la répression a été particulièrement violente. Les communautés de la nationalité Kichwa de cette province se sont en effet largement organisées pour occuper les axes de l’autoroute Panaméricaine menant à la capitale de Quito.
Face à la grève, le président Daniel Noboa a réaffirmé qu’il ne dialoguerait pas avec la CONAIE, estimant que son gouvernement était confronté à des actes de terrorisme déguisés en manifestations. Cette déclaration a été interprétée par les mouvements sociaux comme une criminalisation claire du droit de manifester.
Dès le premier jour de grève et durant les jours suivants, la répression militaire s’est déployée avec puissance notamment en militarisant la ville d’Otavalo et les communautés avoisinantes, en déployant l’usage de gaz lacrymogènes, de tirs à balles réelles, de dizaines de détentions arbitraires et plusieurs cas de disparitions. Malgré tout, les communautés kichwa d’Imbabura résistent et maintiennent leur occupation de l’espace public. (…)
(…) Lire la suite de l’article ici
Équateur : La Via Campesina dénonce la criminalisation et la répression brutale contre les peuples autochtones, les paysan·nes et les secteurs sociaux (Pressenza)
Depuis une semaine, en Équateur, une grève nationale convoquée par le mouvement indigène, en collaboration avec d’autres secteurs sociaux organisés de l’Équateur (travailleur·euses, étudiant·es, femmes et syndicats) se déroule en réponse aux mesures d’ajustement économique. La Vía Campesina, se joint à la voix de cette lutte qui dénonce les graves impacts du néolibéralisme sur la vie de la population, notamment ceux des accords antidémocratiques du Fonds Monétaire international (FMI). Nous exigeons la fin de la répression, de la criminalisation et des projets extractivistes qui portent atteinte à la vie des personnes et à la nature.

Nous réaffirmons qu’en Équateur, le droit à la résistance est établi dans l’ article 98 de la Constitution de 2008. Nous dénonçons les manœuvres politiques de Daniel Noboa qui visent à organiser un référendum et à convoquer une Assemblée constituante afin de consolider un régime autoritaire pour perpétuer un modèle qui bafoue les droits légitimes des peuples. Ce référendum vise en effet à autoriser l’installation de bases militaires étrangères et à supprimer l’obligation de l’État d’allouer des ressources aux organisations politiques.
Par ailleurs, la constitution actuelle, en date de 2008, reconnaît non seulement les droits collectifs des peuples et nationalités autochtones, mais leur accorde également le droit de prendre des décisions concernant leurs territoires afin d’éviter les impacts des industries extractives et de préserver leur culture. Il s’agit de la première constitution au monde à reconnaître les droits de la nature. Mettre fin à la constitution actuelle signifie mettre fin à la réforme agraire pour les paysan·nes et supprimer tous les droits collectifs, la souveraineté alimentaire et l’économie populaire et solidaire. L’objectif est de s’emparer de tous les biens naturels, de la terre, de l’eau, des minéraux et de la biodiversité, et de les remettre aux mains des puissances capitalistes nationales et multinationales.
(…) Lire la suite de l’article ici
Leer en español aquí
Équateur : Quand l’État transforme la protestation en théâtre de guerre (Gabriel Schwarb / Acid Report)
À l’aube du 22 septembre, Pijal s’est réveillée au son de bottes militaires foulant la terre ancestrale et aux détonations de fusils d’assaut perçant l’air des Andes. Cette investigation documente comment le gouvernement de Daniel Noboa a converti une protestation constitutionnelle contre la hausse du diesel en l’opération répressive la plus brutale depuis le retour démocratique : 59 détentions officielles, trois disparitions forcées confirmées, perquisitions domiciliaires avec munitions réelles contre des civils et le blocage financier d’organisations indigènes sur “ordres étatiques”.
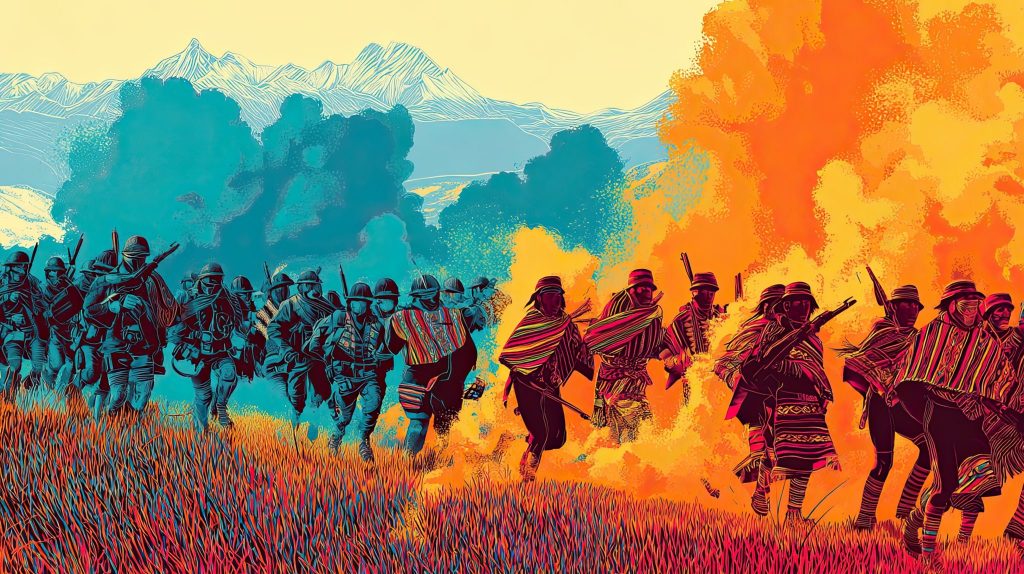
Le ministre John Reimberg accuse sans preuves des manifestants d’appartenir au “Tren de Aragua”, justifiant ainsi le déploiement d’”armement de guerre” contre les communautés rurales d’Imbabura. Wambra Medio Comunitario a enregistré des tirs directs contre des habitations familiales pendant que des enfants dormaient à l’intérieur. Elena Rodríguez Yánez de teleSUR a documenté les témoignages d’un mineur qui conserve des douilles de bombes lacrymogènes “comme des trophées qu’il n’aurait jamais dû posséder”. Si vous ne pouvez lire que ceci, retenez cela : l’Équateur expérimente la militarisation la plus extrême de la protestation sociale de son histoire démocratique, avec un État qui a choisi la guerre psychologique plutôt que la négociation politique.
Géographie de la terreur : Imbabura comme laboratoire répressif
Pour comprendre l’ampleur des événements, il faut visualiser la carte. La province d’Imbabura s’étend sur 4.599 kilomètres carrés de territoire andin, depuis les 1.640 mètres d’altitude à Urcuquí jusqu’aux 4.630 mètres du Cotacachi. Ses 476.257 habitants, dont 35% d’indigènes kichwas, vivent dispersés dans des communautés rurales connectées par la route E35 Panaméricaine Nord, l’artère qui unit l’Équateur à la Colombie et que le gouvernement devait maintenir ouverte à tout prix.
La communauté Pijal, épicentre de la répression la plus brutale, se situe dans la paroisse González Suárez du canton Otavalo, à 2.550 mètres d’altitude et à peine 110 kilomètres au nord de Quito. Ses 847 habitants, majoritairement agriculteurs kichwas, vivent dans des maisons d’adobe et de tuiles dispersées sur des pentes de culture qui descendent vers le lac San Pablo. De là, on domine visuellement le corridor de la E35, position stratégique qui explique pourquoi l’Armée a décidé de convertir cette communauté ancestrale en champ de bataille.
Otavalo, ville de 51.000 habitants mondialement connue pour son marché indigène, s’est transformée en zone de guerre urbaine quand plus de mille manifestants ont encerclé le Commandement de Police local. La géographie urbaine a facilité la confrontation : rues étroites du centre colonial qui débouchent directement sur la place centrale, où se concentrent tant l’autorité civile que les symboles du pouvoir étatique.

Donnée clé : Le corridor stratégique E35
La Panaméricaine Nord E35 transporte 68% du commerce bilatéral Équateur-Colombie, valorisé à 1.200 millions de dollars annuels. Chaque heure de fermeture représente des pertes de 2,3 millions de dollars, selon les données du ministère des Transports. Cette dépendance économique explique pourquoi Noboa a autorisé l’usage de “toute force nécessaire” pour maintenir la route ouverte, incluant l’entrée de patrouilles militaires dans des domiciles civils de communautés comme Pijal, où les maisons familiales se situent à moins de 200 mètres de la voie principale.
Contexte Historique : l’ADN de la résistance andine
Imbabura n’a pas été choisie au hasard comme épicentre du Paro Nacional 2025. Cette province concentre la mémoire historique des victoires populaires les plus importantes de l’Équateur contemporain. En octobre 2019, les communautés kichwas d’Otavalo et Cotacachi ont résisté 11 jours d’état d’exception jusqu’à forcer Lenín Moreno à abroger le “paquet” fondomonétariste. En juin 2022, depuis ces mêmes pentes andines sont parties les colonnes indigènes qui ont marché 18 jours jusqu’à obtenir que Guillermo Lasso réduise le prix des carburants.
Mais 2025 marque une différence qualitative : Daniel Noboa est arrivé à Carondelet en étudiant les “erreurs” de ses prédécesseurs. Son équipe de conseillers, dirigée par des spécialistes en contre-insurrection formés dans des écoles militaires états-uniennes, a conçu une stratégie différente. Au lieu d’attendre l’escalade, ils ont anticipé la répression. Au lieu de négocier des territoires, ils ont militarisé préventivement. Au lieu de criminaliser après, ils ont construit le récit du “terrorisme” avant le début des protestations.
Le résultat fut la conversion d’Imbabura en laboratoire de répression préventive où chaque technique de contrôle social a été expérimentée pour la première fois : du blocage financier d’organisations à l’usage de munitions réelles contre des manifestants civils. (…)
(…) Lire la suite de l’article ici
Leer en español aquí
El Paro Nacional 2025 : una minga de voces (Gabriela Ruiz Agila / Wambra Comunitario)
La madrugada del 22 de septiembre marcó el inicio del Paro Nacional de 2025. Lo que empezó como bloqueos en carreteras y plantones se convirtió en una minga de voces desde la Sierra, la Amazonía y la Costa. Comunidades indígenas, campesinas, estudiantes y organizaciones sociales se unieron para denunciar el alto costo de la vida, el autoritarismo del gobierno y la criminalización de la protesta.
El 18 de septiembre, se registraron bloqueos en las vías de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo. Un malestar que ha ido creciendo según el estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) que revela que el 83% de los encuestados en Guayaquil y Quito se sienten afectados por la medida.
Ese mismo día, la Conaie convocó a un Paro Nacional inmediato e indefinido con el apoyo de Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice). Llamaron a las bases a rechazar el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, así como el paquetazo neoliberal, la crisis en salud y educación y el abandono estatal y al modelo extractivista.
El galón de diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80 lo que representa un sobrecosto de al menos USD 570 mensuales por bus urbano, y traerá en consecuencia, el incremento de pasajes para transporte público y encarecimiento de la cadena de valor en la producción y servicios.
Tras varios levantamientos previos (2019, 2022), las dirigencias no se concentran únicamente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sino en redes ampliadas: organizaciones campesinas, feministas, estudiantiles, sindicales y barriales.
“Quienes protestamos no somos delincuentes ni enemigos del Ecuador. Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los derechos de todos.Nos llaman terroristas para justificar la represión, pero somos campesinos, agricultores, comerciantes, estudiantes, madres, artistas… Somos el pueblo que sostiene este país con dignidad y esfuerzo”, es el mensaje de Nemo Guiquita miembro del Consejo de gobierno de CONAIE.
A continuación, un recorrido por las escenas, los nombres y las demandas que alimentan esta jornada de resistencia. (…)
(…) Seguir leyendo aquí
Voir également :
– Équateur. Manifeste en défense de la liberté, de l’intégrité personnelle, de la vie, de la protestation sociale et de l’État constitutionnel des droits et de la justice
– Ecuador. Manifiesto en defensa de la libertad, integridad personal, vida, protesta social y el Estado constitucional de derechos y justicia
– Ecuador: Alerta por represión a protestas, independencia judicial y desapariciones forzadas (Amnistía Internacional)


